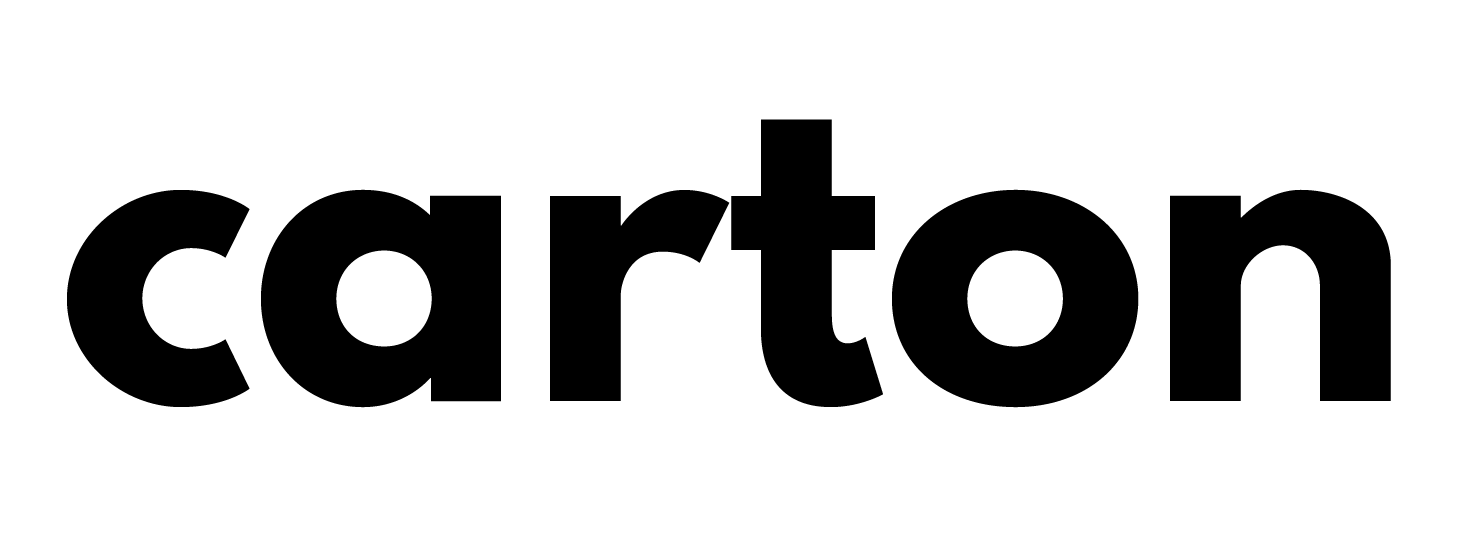gilles poizat | micro-vertige et l'expérience du flottement @ l'oreille absolue
"Se construire et créer à sa façon"
Nouveau pensionnaire de l'excellent label Carton, GILLES POIZAT s'avance en éclaireur doucement allumé sur les terres d'un
songwriting anglo-français où le rêve peut se transformer en expérience, la recherche en poésie et la pensée en montée de
fèvre. Entretien avec un véritable maître alchimiste.
Gilles Poizat : J'ai commencé la musique tout gamin, en entrant au conservatoire à 6-7 ans et en y apprenant la trompette à
partir de 8 ans. Depuis, je n'ai jamais arrêté de jouer, même si, pendant longtemps, je n'en ai pas fait un métier… A l'âge
où j'étais au lycée, l'ambiance, dans la classe de trompette, était à la professionnalisation. Moi, j'étais un peu dans l'entredeux.
J'ai vaguement pensé à suivre cette voie, mais je ne bossais pas assez l'instrument pour passer les examens, je
n'avais pas non plus d'horaires aménagés au lycée. Je suis entré en fac de biologie, et comme ça m'a beaucoup plu j'ai pris
ce chemin. Mais je n'ai pas barré la musique de ma vie. C'est même après le conservatoire que j'ai commencé à monter des
groupes. J'ai ensuite passé de nombreuses années à me demander si je voulais continuer à être chercheur en biologie ou si
je voulais me consacrer à la seule musique. Je me suis longtemps posé la question de ma légitimité.
Une question que tu liais à tes compétences en tant que musicien ?
Non, plutôt à cette idée de faire de la musique un métier. Qu'est-ce que j'ai vraiment à faire sur scène ? C'est toute la
question de l'esprit et du rôle social de l'artiste. Pourquoi est-ce lui qui est sur scène et s'exprime devant les gens ? Qu'estce
qu'il a de si intéressant à dire pour qu'on l'écoute avec attention ? Bon, aujourd'hui, j'ai un peu dépassé ces
interrogations. Je me suis légèrement détendu…
Le fait de jouer dans des groupes, notamment depuis 2002 au sein du collectif Mazalda, où tu es par nature moins exposé
que dans une confguration solo, n'a pas atténué ces questionnements ?
Oui et non. J'ai par exemple longtemps joué avec une fanfare, Musicabrass, qui a été créée dans les années 80 et qui a été
assez novatrice dans le spectacle de rue, notamment en utilisant l'improvisation musicale et en jouant avec les situations,
les contextes, en apportant quelque chose d'absurde et de comique. J'aimais ça, ça m'attirait vraiment beaucoup. Mais
j'avais l'impression de ne pas être moi-même assez libéré pour pouvoir jouer comme ça avec les codes de la vie sociale.
Dans ma propre existence, je ne suis pas très à l'aise avec eux… Tout ça m'a donc amené à me poser des questions. Pour
moi, ces doutes rejoignent le fait que j'ai beaucoup de mal à écrire des paroles, surtout en français. Je me demande si j'ai
vraiment quelque chose à dire… Ce qui, aujourd'hui, me plaît dans mon projet solo, c'est qu'il m'a permis de trouver un
petit chemin pour me creuser une place. Une place qui n'est pas déterminée par d'autres musiciens, et qui se situe à une
échelle qui me correspond.
Cette question de la légitimité, tu ne penses pas qu'elle peut se poser dans tout corps de métier ?
Si, certainement. Elle se pose aussi dans la recherche, d'ailleurs… Mais la grande diférence, c'est qu'il y a dans ce milieu un
côté académique : tes diplômes ou ton poste t'octroient automatiquement une autorité, ou au moins une légitimité. Dans
la filière de la musique classique, je suppose que ça peut fonctionner de la même façon. Mais dans mon cas, et dans le
type de musique que je joue, il n'y a aucun de ces critères académiques. Et c'est ce qui, finalement, m'a attiré et m'a
amené, fin 2004, à lâcher la recherche et à devenir intermittent. A partir de là, c'était vraiment à moi de mener ma barque,
de vivre d'une activité qui ne dépendait que de moi, et pas de mes diplômes. J'ai suivi cette logique jusqu'au point de me
retrouver aujourd'hui à me produire sous mon nom avec un instrument, la guitare, dont je ne sais pas jouer de manière
orthodoxe.
Pour quelqu'un qui doute, tu ne crains quand même pas de te jeter à l'eau.
Oui, mais je mets du temps, quand même, hein… J'hésite pas mal sur le plongeoir…
En musique, je trouve important de ne pas forcer les choses. Il m'a fallu des années à jouer de la trompette dans des
contextes de groupe avant que je mette à l'écriture de chansons guitare-voix. Avec Micro-vertige et l'expérience du
fottement [en écoute ici dans Le Creux de L'Oreille], je me suis retrouvé en situation de débutant. La guitare, j'en jouais
depuis l'adolescence, mais dans ma chambre. Jamais je ne l'avais pratiquée dans un groupe ou devant les gens. Au départ,
cette histoire en solo était donc très fragile, et ça s'est d'ailleurs passé tout doucement. J'ai joué certaines de ces chansons
avec Mazalda, d'autres ne collaient pas avec le répertoire du groupe. Ensuite, on a essayé une formule en trio, avec batterie
et orgue. Mais comme je ne suis pas très assuré à la guitare, et que jouer avec d'autres me stressait un peu, j'ai finalement
eu envie de voir ce que ça donnerait tout seul.
Comment expliques-tu ce passage assez tardif au solo ?
Quand on apporte une chanson à un collectif, chacun fnit par se l'approprier – sauf si, d'entrée, on en a une idée vraiment
très claire. Ça peut être l'un des bons côtés du travail de groupe, mais à force, on perd un peu le fil, son fil. J'ai donc voulu
me rapprocher de la chanson, dans la solitude. C'était à la fois vraiment flippant et intrigant : j'étais très curieux de voir ce
que ça allait donner.
Tu n'avais donc pas de pistes ni de plans particuliers, tu ne savais pas trop où tu mettais les pieds ?
Musicalement, j'avais bien quelques idées. Mais encore une fois, tout s'est mis en place graduellement, ponctuellement. De
temps à autre, ici et là, des relations et copains m'ont proposé de me produire tout seul. Maintenant, une fois l'album
enregistré, avec tout le temps et toute l'énergie que j'y ai mis, j'ai envie qu'il soit un peu écouté. En matière de disques,
mes expériences précédentes, que ce soit avec Mazalda ou avec Greg Gilg [Gilles Poizat a participé en tant
qu'instrumentiste à l'enregistrement de l'album de ce dernier, 14:14] par exemple, ont toujours été un peu les mêmes : on
réalise un disque, mais comme il n'est pas distribué, qu'il n'y a pas de label ni de promo, il n'existe pas vraiment, il ne se
passe pas grand-chose, en dehors des ventes qu'on peut faire aux concerts. Je trouve ça dommage. On aboutit un projet,
et ça n'ouvre pas de portes, ça ne provoque pas de rencontres. Pour Micro-vertige…, c'est un peu diférent, puisque j'ai eu
cette proposition de Seb Brun, du label Carton. Ça m'a beaucoup plu, parce que, là aussi, il n'y a rien eu de forcé,
d'artifciel. J'ai d'abord rencontré Guillaume Magne [du groupe OK, également impliqué dans le label Carton] il y a quelques
années, via MySpace : chacun appréciait les chansons de l'autre, on s'est partagé des concerts à Paris, à Lyon et dans la
région… La connexion s'est tissée comme ça, naturellement, au fil du temps. Du coup, lorsqu'il m'a été proposé d'être sur
Carton, ça avait vraiment un sens. Le fait d'avoir sorti le disque sur un label a généré des chroniques sur internet : tout ça a
contribué à me donner un peu confance. Pour la première fois, j'ai démarché activement des lieux, recherché des dates.
C'est quelque chose je n'avais jamais fait auparavant. Aujourd'hui, même si je suis toujours bien occupé par Mazalda, et
par d'autres groupes dans lesquels je joue, c'est le solo qui m'occupe le plus l'esprit.
As-tu l'impression d'être un musicien différent depuis que tu t'es lancé dans la composition et le jeu en solo ?
Je n'ai pas changé fondamentalement, j'ai simplement le sentiment d'avoir avancé. Là où je me suis un peu découvert, c'est
dans le fait d'oser être là, seul, face à un public. Ce qui est particulier, notamment parce que je n'utilise pas de boucles ou
de choses comme ça, c'est que ça peut s'arrêter à chaque instant. C'est très diférent de mes expériences en tant que
trompettiste dans des groupes : là, si je m'arrête, la musique peut continuer sans moi. En solo, tout ne dépend que de moi.
Je peux foirer un passage, ou choisir de suspendre mon geste, d'amener un moment de silence que je laisse vivre… Autant
de choses que je découvre et avec lesquelles j'aime bien jouer.
Tu dis "foirer un passage" avec un grand sourire, comme si ce n'était pas du tout un drame.
Au début, j'avais vraiment du mal à me concentrer sur la durée d'un concert et je me trompais souvent d'accord. Là dessus,
j'ai avancé. Aujourd'hui, si je me plante, je ne le cache pas et je reprends : ça passe. Le problème, quand tu te
trompes à répétition, c'est que ça te met vite dans la peau du musicien vulnérable, maladroit. Et ça, au bout d'un moment,
je trouve que ça casse quelque chose. Il y a des gens, aujourd'hui, qui me disent : "Ah, on aimait bien quand, au début, tu
n'arrêtais pas de te planter, c'était vraiment fragile !" Oui, c'était peut-être marrant, mais moi j'ai envie de quelque chose
de plus solide. La fragilité, je l'aime à travers l'idée que ça peut s'arrêter à chaque instant. Pas à travers le fait que je
connaisse mal mes morceaux ou que j'aie du mal à rester concentré : ça, ça n'est pas très intéressant, je ne vois pas ce que
ça apporte…
D'autant que, sur disque, tes chansons ne reposent pas du tout sur cette idée de fragilité. Elles expriment même un certain
souci de précision, et véhiculent une dynamique, la volonté d'aller d'un point A à un point B.
C'est en tout cas ce que j'essaie de réaliser.
En dépit du format qui s'y rattache et du nombre limité d'outils que tu t'es donné (guitare, voix, trompette), tes chansons
balaient un spectre expressif assez large : il y a des moments où la matière sonore est dense, d'autres au contraire où elle
est plus diluée et épurée, des passages où elle est chaotique et d'autres où elle est plus stable.
J'aimerais bien que ce travail sur la matière transparaisse, oui. Je voudrais d'ailleurs aller encore plus loin dans cette
direction, en créant des ambiances sonores assez larges. Mais ça, aussi, ça demande une certaine forme d'assurance, des
choix assumés. Sur scène, j'utilise des pédales d'efets qui me permettent d'enfler et de suspendre le son. J'aime bien, par
exemple, régler les delays à la limite de l'emballement du feedback : certaines notes enflent sans qu'on sache trop si ça va
aller vers un larsen ou si ça va tenir. Oser laisser la musique se développer, jouer avec ce qu'elle a de mouvant et de limite,
tenir une durée, ne pas aller tout de suite vers ce qui est accrocheur, faire entrer les gens dans cette expérience-là : ce
sont des choix qui me plaisent et que j'aime prendre. Mais il m'arrive de douter, de me dire que je me trompe de propos,
que les gens vont être perdus. J'ai encore beaucoup de choses à explorer dans ce domaine.
Cette variété dans les approches rappelle qu'en tant que musicien, tu es d'une grande souplesse, d'une grande capacité
d'adaptation : dans les expériences de groupe, tu as toujours eu cette faculté de passer d'un univers à un autre.
Il y a plein de façons de faire et d'écouter de la musique, que j'aime de la même façon. Que ce soit de la musique
improvisée, plus basée sur le son, ou de la chanson plus pop, que ce soit de la musique ancienne ou des expressions plus
modernes : j'aime côtoyer toutes ces réalités et ces pratiques-là. Dans Mazalda, on est dans un fonctionnement purement
oral, on s'apprend les morceaux entre nous, qu'il s'agisse de reprises de musiques populaires de tous les pays ou de
compositions originales : chacun trouve plus ou moins son arrangement, le processus est collectif. Parallèlement, je joue
aussi dans un orchestre de neuf musiciens qui s'appelle Le Grand Bal des Cousins : là, tout est écrit à la note près, tout est
centralisé par le directeur de l'ensemble, Etienne Roche. Cette expérience-là, qui consiste à déchifrer et à découvrir
comment l'arrangement sonne avec les autres, est donc complètement différente. Mais j'aime tout autant ces deux
approches. J'aime aussi, dans l'improvisation libre, l'état et l'écoute qu'exige cette façon de tourner autour de la matière
sonore, qu'on soit musicien ou auditeur. Il faut faire un peu de vide en soi, laisser de la place… Alors que d'autres formes
plus accrocheuses, plus séduisantes d'entrée, ne demanderont pas cette démarche ; et ça fait du bien aussi.
Dans les chroniques qui ont été écrites au sujet de ton disque, reviennent de manière récurrente des fliations avec toute
une nébuleuse de songwriters anglais composée d'individualités comme Syd Barrett, Robert Wyatt ou Kevin Ayers.
Trouves-tu ça fatteur, surprenant, un brin paresseux ?
Je ne me suis pas dit que j'allais écrire "à la manière de", mais c'est évidemment fatteur : ce sont des gens que j'ai pas mal
écoutés et que j'aime, en particulier Barrett et Wyatt. Derrière eux, je vois d'autres infuences communes entrer en jeu :
chez Barrett, par exemple, j'entends aussi de la musique ancienne, qu'il a réinjectée dans des atmosphères plus planantes
– mélange auquel je suis moi-même très sensible.
Ce qui, dans l'esprit, peut te rapprocher d'un Robert Wyatt, c'est cette façon de refuser la banalité, dans l'harmonie comme
dans la conduite et la construction des chansons, sans tomber non plus dans le piège de la complexité à foison. Dans ce
jeu-là, la guitare a-t-elle été une précieuse alliée ?
Je ne suis pas du tout un bon joueur de clavier, mais quand je me retrouve devant les touches, j'adore plaquer un accord et
imaginer ceux que je pourrais enchaîner derrière. Les chemins d'accord, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et pour
ça, la guitare permet efectivement d'en tracer, même s'il y a des contraintes au niveau du doigté… Chez Wyatt, j'aime
beaucoup ce rapport à l'harmonie, oui. Et son phrasé, aussi, son accent anglais qui, comme Syd Barrett, a sans doute
infuencé le mien. Après, pour sortir du domaine strictement anglais, quelqu'un comme Arto Lindsay m'a également
beaucoup marqué. J'aime chez lui ce mélange de questionnements sur soi et d'expressions par moments complètement
lâchées, ce mélange de doute et d'assurance. Je suis aussi allé voir Leonard Cohen lors de sa dernière tournée. Et j'ai été
frappé par l'image de cet homme qui a vraiment décidé de faire de la chanson à sa façon, sans se la jouer showman. C'est
très inspirant, ça. Personnellement, je ne me suis jamais senti de faire du divertissement, de jouer un rôle. Ce ne serait pas
moi. Ça deviendrait un job, un truc préfabriqué, sans intérêt. Avec Mazalda, nous nous sommes aussi vraiment construits
dans cette idée-là. On nous a souvent reproché, d'ailleurs, de ne pas parler sur scène, de ne pas être expansifs, etc. Mais
peu importe. Rencontrer ces gens-là m'a conforté dans l'idée qu'il fallait se construire et créer les choses à sa façon.
Pour en fnir avec Wyatt et toi : il y a entre vous un goût commun pour une certaine forme d'absurde, ou de fantaisie.
Ça, c'est quelque chose que je ne contrôle vraiment pas. J'ai même du mal à en jouer facilement. Je crois que ça vient du
fait que je n'ai pas un goût tellement prononcé de l'écriture et de la langue, comme peuvent l'avoir par exemple des gens
comme Bertrand Belin, ou encore Sing Sing et Eloise Decazes [de Arlt], que j'ai rencontrés en participant à l'enregistrement
de l'album de Greg Gilg. Leur approche m'attire beaucoup, mais je n'arrive pas du tout à avoir la même, ou alors très
difficilement. Est-ce que c'est parce que je n'ai vraiment pas grand-chose à dire, ou parce que j'ai vraiment trop
d'autocensure ? Il y a sans doute un peu des deux. C'est peut-être pour ça, aussi, que j'utilise majoritairement l'anglais : il
m'ouvre un terrain plus neutre, plus libre, où je me bride moins. J'aimerais écrire davantage en français, parce que je
trouve parfois bizarre de chanter en anglais devant un public français : je tends vers un maximum de simplicité, et à mes
yeux le choix de l'anglais ressemble par moments à un artifice, une façon de noyer le poisson. Mais j'ai encore trop de
blocages avec notre langue. Peut-être que je ne prends pas assez de temps, peut-être qu'il faudrait que je fasse des jeux
d'écriture, pour me libérer.
Chez toi, l'écriture n'est donc pas une pratique naturelle ?
Non. J'ai essayé, mais j'ai toujours trouvé ça lourd… Ça m'attire beaucoup, mais je voudrais atteindre une forme de légèreté
et d'ouverture qui m'échappe le plus souvent. Dans mon cas, les textes en français ont tendance à prendre beaucoup de
place et à tout écraser. Il est aussi plus dur d'être dans le son, dans la musique des syllabes : le sens prend vite le dessus,
chaque mot est chargé de sous-entendus… Dans mon cas, l'anglais m'amène donc à une forme de naïveté qui m'allège.
Tu évoquais tout à l'heure ta légitimité de musicien. Dans Micro-vertige et l'expérience du fottement, la question de la
place qu'on occupe, qu'on doit se trouver, à une petite comme à une grande échelle, dans l'environnement humain le plus
proche comme dans le vaste monde, se pose dès Proper Dance, le premier titre. C'est un thème qui court au long de
l'album.
J'ai écrit coup par coup, je n'avais pas de schéma prédéfni. Mais je me suis rendu compte a posteriori que l'album parlait
pas mal de ça, oui.
Tes anciennes activités dans la recherche ont-elles nourri ton écriture ? Avant même de savoir que tu étais chercheur, je
trouvais que tes textes, qui n'empruntent pas les registres du récit ou de la confidence, étaient construits comme de
petites études, des observations.
Je m'en suis aussi aperçu à travers les thèmes des chansons. Certaines d'entre elles ont même été carrément inspirées par
ces activités. Parasite, par exemple, est née d'une conférence qu'un collègue de labo avait donnée sur un parasite qui
change le comportement de ses hôtes – en l'occurrence des crevettes – pour favoriser sa reproduction. Une fois parasitées,
les crevettes, au lieu de se planquer au fond de l'eau, tournent à la surface : du coup, les oiseaux les bouffent
préférentiellement. Or, ces parasites ont besoin de passer par un tube digestif d'oiseau pour accomplir leur cycle de
reproduction… Dans ce cas-là, l'inspiration, transposée sous une autre forme, découle donc directement de ce qu'était
mon métier de chercheur. Moment de force s'appuie aussi sur les notions de systèmes mécaniques et de forces pour
illustrer la prise de décision et les hésitations qui peuvent l'entourer. Il y a aussi une chanson sur les statistiques… Je dois
dire que ça m'a fait plaisir de pouvoir tracer des liens entre ces thèmes-là et la musique. Des sujets comme l'évolution
continuent de m'intéresser vraiment, je lis encore des choses à ce propos ; ça reste présent dans mon esprit.
Du coup, on ressent aussi dans tes chansons cet écho et cet impact intimes que l'étude du vivant peut avoir dans le corps
comme dans l'esprit du chercheur.
C'est évident. Par exemple, j'ai longtemps travaillé sur les stratégies de reproduction de l'épinoche, un petit poisson. Par la
théorie de l'évolution, tu es amené à des schémas, des façons de voir les choses, des compromis. La grande question,
c'est : est-ce qu'on met toute notre énergie dans la reproduction, d'un coup, au détriment de notre survie, ou est-ce qu'on
ménage notre survie en étalant dans le temps l'énergie qu'on place dans la reproduction ? A travers ces expérimentations
et ces théories, il y a aussi une certaine satisfaction à essayer de simplifer des choses qui sont complexes. Et ça crée
forcément une résonance par rapport à nos propres modes de vie, notre propre manière de nous reproduire, ou pas. Ce
n'est pas du tout cloisonné… A ce propos, aussi, l'utilisation de l'anglais renvoie d'une certaine façon à mon passé de
chercheur : la plupart des articles que je lisais, ou que j'ai pu écrire, étaient dans cette langue. J'ai donc un rapport
particulier à l'anglais – renforcé par le fait que j'ai vécu un an aux Etats-Unis quand j'étais petit, en allant à l'école
américaine. J'ai un vrai goût, ancré et ancien, pour cette langue, qui s'est aussi exprimé par les musiques que j'ai pu
écouter par la suite. En plus, l'anglais scientifique est assez simple : dans une discipline ou un sujet donnés, il n'y a pas dix
mille mots de vocabulaire. Je crois que ça transparaît dans mon disque. Ma manière d'écrire des phrases vient aussi de
mon expérience et de ma pratique de l'anglais dans le cadre de la recherche.
Sais-tu vers quoi ouvre la suite de tes aventures en solo ? Ou est-il trop tôt pour distinguer une direction, un horizon ?
J'ai plusieurs nouveaux morceaux en chantier, mais je n'ai pas de paroles, justement… Ce n'est pas une partie du travail
que je contrôle. Je ne peux pas me dire : cet après-midi, je vais avancer sur tel texte. Tout ce que je sais, c'est que j'ai cette
envie de poursuivre cette expérience, de prolonger le fil.